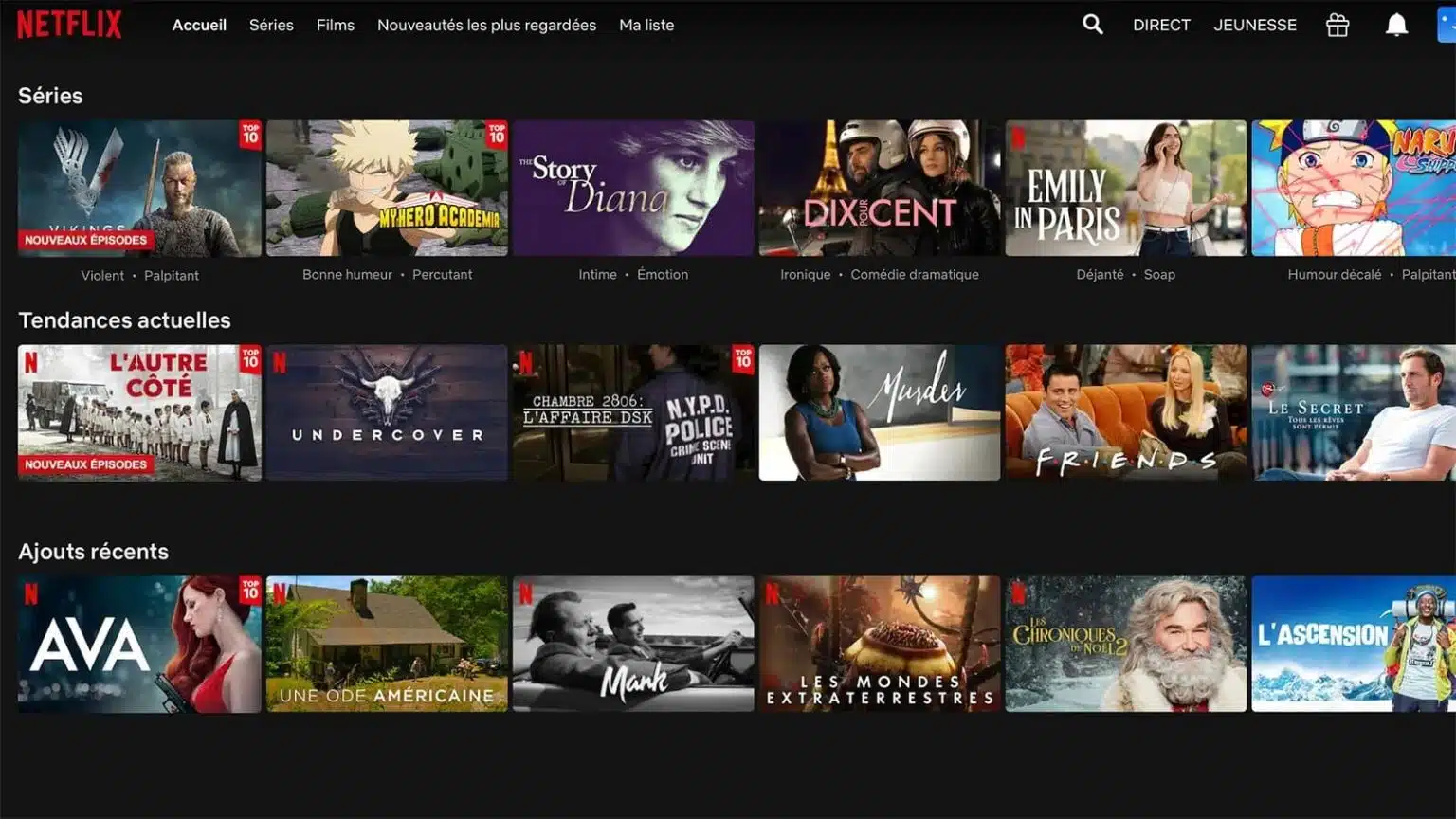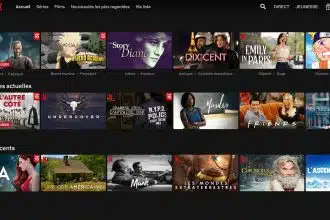En 2022, 70 % des nouveaux emplois créés dans les économies émergentes dépendaient de compétences scientifiques ou technologiques. Pourtant, seuls 18 % des budgets publics y sont consacrés dans ces mêmes pays. Le décalage entre investissement et rendement interroge les politiques de développement.
Certains États parviennent à doubler leur croissance en cinq ans en misant sur l’innovation, tandis que d’autres stagnent malgré des ressources naturelles abondantes. Les chiffres de l’UNESCO révèlent que chaque dollar investi dans la recherche rapporte en moyenne 2,2 dollars au PIB. Ce ratio souligne un levier de transformation encore sous-exploité.
Science et technologie : des leviers incontournables pour un développement durable
La science et technologie ne font pas de bruit, mais elles impriment leur marque dans le quotidien des sociétés qui cherchent à se réinventer. Les objectifs de développement durable défendus par les Nations unies rappellent que seule la connaissance permet de sortir des impasses récurrentes. S’appuyer sur l’innovation et la recherche, c’est injecter une dose de solutions tangibles : agriculture de précision, exploitation raisonnée des ressources, énergies renouvelables à grande échelle. À chaque étape, chaque technologie déployée pour le développement change la donne pour un territoire.
Les universités occupent un rôle central en formant des chercheurs capables de décoder l’évolution rapide du monde. Sur le terrain, la recherche se traduit par des expérimentations : irrigation intelligente, dispositifs médicaux accessibles, réseaux d’information ruraux. Ces innovations répondent à des besoins concrets et, surtout, renforcent la capacité des pays à inventer leurs propres solutions.
Voici deux dynamiques qui façonnent l’impact de la science et technologie sur le développement :
- La coopération entre centres de recherche et acteurs publics accélère l’arrivée des technologies innovantes dans les communautés.
- L’accès à des données fiables et à l’information scientifique détermine la possibilité de fonder des politiques sur des faits tangibles.
Maîtriser les sciences et technologies, ce n’est pas seulement inventer. C’est aussi diffuser les savoirs, former en continu, associer les citoyens. Les défis du développement durable imposent un changement de cap : la recherche et la technologie doivent devenir la colonne vertébrale de toute stratégie de transformation.
Quels défis majeurs freinent l’intégration de l’innovation dans les stratégies de développement ?
Les ambitions sont souvent affichées, mais la réalité du transfert de technologies vers les pays en développement se heurte à des obstacles ancrés dans la structure même des sociétés. La capacité technologique varie fortement d’un pays à l’autre. Certains investissent dans l’éducation scientifique et la formation d’ingénieurs, tandis que d’autres n’offrent pas les bases suffisantes dès la scolarité primaire.
Le fossé numérique se creuse également. L’accès aux technologies de l’information suppose à la fois des infrastructures solides et des politiques publiques cohérentes. Installer des solutions numériques dans les zones rurales ne suffit pas : il faut aussi accompagner et former les utilisateurs pour qu’elles s’ancrent dans le quotidien. Sinon, les outils restent inertes, sans impact réel.
Voici quelques blocages récurrents observés dans le déploiement de l’innovation :
- Les inégalités d’accès au savoir scientifique ralentissent la diffusion de toute innovation pour le développement.
- Le manque de coordination entre universités, entreprises et pouvoirs publics entrave l’implantation durable des projets.
Les pays en développement font aussi face à l’instabilité du financement. Les initiatives pilotes impulsées par des bailleurs internationaux s’essoufflent souvent faute de relais locaux. Et lorsque les innovations sont perçues comme extérieures, la méfiance freine leur adoption.
Sans convergence entre sciences, ressources locales et engagement politique, même les meilleures avancées risquent de s’éteindre avant d’avoir changé les choses. Faire progresser l’innovation demande plus qu’un arsenal technologique : il faut une vision collective et l’envie de réduire les écarts, pour que la technologie devienne un véritable moteur de développement.
Exemples concrets : quand la recherche scientifique transforme l’économie et la société
Pas besoin d’aller chercher loin pour voir comment sciences et technologies bouleversent l’économie et la société, souvent bien au-delà des laboratoires. Sur le continent africain, les avancées issues de la recherche irriguent les filières agricoles. Prenons le Kenya : la généralisation du paiement mobile M-Pesa, née d’une rencontre entre chercheurs et entrepreneurs, a permis à des millions de personnes d’accéder à des services financiers de base. Cette technologie innovante a propulsé l’économie informelle et favorisé l’inclusion.
Le rôle des universités se mesure aussi à Dakar, où la synergie entre chercheurs et entrepreneurs locaux débouche sur des solutions de terrain : applications pour piloter l’irrigation, outils de suivi de la santé, plateformes éducatives connectées. Ce maillage entre recherche, innovation et économie crée une dynamique vertueuse : de la connaissance, on passe à l’emploi, puis à la transformation sociale.
Deux exemples illustrent cette capacité de la recherche à impacter la société :
- En Afrique du Sud, des programmes de sciences et technologies soutiennent l’émergence de la médecine personnalisée, apportant de nouveaux outils dans la lutte contre le VIH.
- Au Maroc, le développement des énergies renouvelables, impulsé par des partenariats entre universités et industrie, démontre comment la recherche scientifique peut réorienter l’économie vers plus de durabilité.
Le partage de ces connaissances scientifiques fait émerger de nouvelles compétences au sein des populations. La mise en œuvre de ces innovations s’enracine dans les réalités locales, révélant la puissance du lien entre recherche et développement pour inventer d’autres modèles économiques et sociaux.
Penser le futur : pourquoi miser sur la science et la technologie pour une croissance responsable ?
Les défis du XXIe siècle imposent de revoir à la racine la façon de penser la croissance économique. Face à l’ampleur des enjeux, la science et la technologie pour le développement ouvrent des pistes inédites. Les chiffres issus du système des Nations unies sont sans appel : sans innovations, la marche vers les objectifs de développement durable s’essouffle. Même la France, forte de son potentiel, reconnaît le besoin de renforcer les liens entre recherche publique, secteur privé et société civile.
Une logique de coopération s’installe peu à peu et redéfinit les rôles :
- Les universités renforcent leurs dispositifs de transfert de connaissances.
- Les acteurs privés misent sur la technologie innovation pour repenser leurs modèles.
- La société civile s’engage sur la voie d’une croissance responsable.
Ce changement s’observe aussi à l’international, avec la multiplication de plateformes collaboratives où s’échangent savoirs, ressources et retours d’expérience. Atteindre de nouveaux objectifs passe par la connexion des réseaux scientifiques, économiques et institutionnels : c’est là que réside un levier puissant pour accélérer le mouvement.
La rencontre entre science, technologie, développement n’a rien d’une formule magique. Son efficacité tient à la volonté d’en faire un bien commun. Investir dans les nouvelles technologies, à condition d’en penser collectivement les usages, permet d’imaginer des trajectoires de développement plus sobres, inclusives et adaptées à la diversité du monde. C’est là que s’inventent, aujourd’hui, les équilibres de demain.